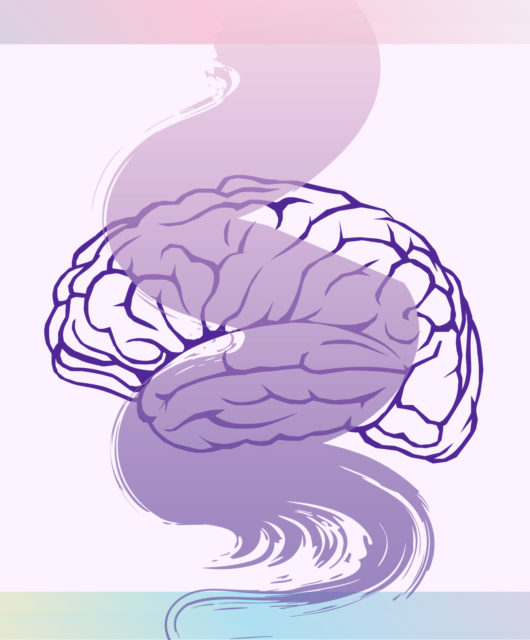L’investigation de A à Z: c’est ce que nous propose notre expert Jean-Philippe Ceppi dans une interview à coeur ouvert. Lancer son média d’investigation, faire face à la polémique, la médiatisation du COVID-19, l’Affaire Darius Rochebin… Jean-Philippe Ceppi nous parle de son domaine de prédilection et de sa riche expérience dans le journalisme d’investigation.
Jean-Philippe Ceppi, présentez-vous !
Je m’appelle Jean-Philippe Ceppi, je suis producteur responsable de l’émission Temps Présent à la Radio Télévision Suisse (RTS) et journaliste de profession. Je me suis spécialisé dans le journalisme d’investigation- matière que j’enseigne actuellement à l’Académie de journalisme de l’Université de Neuchâtel. Je suis également doctorant à l’Université de Lausanne où je travaille sur l’histoire du journalisme d’investigation à la télévision, en particulier sur l’utilisation de la caméra cachée.
Qu’est-ce que le journalisme d’investigation ?
J’essaie de parler de journalisme de précision pour définir le journalisme d’investigation. L’UNESCO définit ce genre comme du journalisme de détail, de précision, qui demande un travail plus long, plus fouillé, plus détaillé et qui va à la recherche de faits cachés. On abuse parfois du terme d’investigation : tout journaliste devrait être un journaliste d’investigation. Son but est toujours de rechercher la vérité des faits et des consciences.
Je suis attaché à l’idée que le journalisme d’investigation doit avoir un impact. Cet impact peut consister en un effet sur la loi, sur l’opinion publique… il doit permette de mettre le doigt sur un dysfonctionnement de la société, et potentiellement de le changer.
Je suis aussi attaché à l’idée du détail et de la précision, c’est-à-dire rechercher un document en particulier, une image, une interview qui vont faire la différence. C’est ce point de détail qui fait la différence entre une enquête et une investigation.
Je suis également attaché à la narration : une enquête d’investigation doit être agréable à lire. Trop souvent, les journalistes d’investigation ont représenté une petite clique qui parlait à une petite clique, notamment en finance ou en économie. Je crois qu’un bon journalisme d’investigation doit être ludique et populaire. Les documentaires de Netflix sont supers là-dedans, car ils s’attaquent à des sujets complexes en les rendant comestibles.
On pense souvent au scandale quand on parle de journalisme d’investigation. Qu’en est-il réellement ?
Dans le fond le scandale, c’est plutôt l’effet. Ce n’est pas le journaliste qui fait scandale, mais les informations qu’il révèle. L’impact commence déjà par l’audience. Un sujet qui a un grand impact est un sujet qui a intéressé beaucoup de gens, qui a été vu pour beaucoup gens, d’où l’importance de la narration. C’est pour cela que je suis attaché à un journalisme populaire, et pas forcément de niche. L’impact peut aussi être d’ordre affectif et émotionnel, par le biais de l’exposition des certaines injustices. Personnellement, je trouve que la satisfaction et le sens du travail d’investigation réside si possible dans la capacité à mettre le doigt sur des dysfonctionnements, et donc d’y mettre fin ou pour le moins d’en faire un objet de débat. Je suis très heureux quand la société civile s’empare d’un sujet de débat après que Temps Présent l’a exposé
Je prends un exemple récent : Temps Présent a exposé les conditions dans lesquelles le représentant suisse à l’Agence de protection des réfugiés palestiniens (UNRWA), Pierre Krähenbühl a dû démissionner des Nations Unies. Ici, l’impact a été de type moral. Ce reportage, d’Anne-Frédérique Widmann et Xavier Nicol, a suscité le débat sur les réseaux quant au manque de soutien de la Suisse. Pour l’instant, ce reportage n’a rien changé, ni pour la vie de Pierre Krähenbühl, ni dans la politique de la Suisse dans la question palestinienne. Mais j’étais quand même très satisfait que ce sujet ait suscité la polémique et le débat. C’est un peu comme un tsunami dans le fond : il y a des vaguelettes, puis des tsunamis.
Comment assurer ses arrières lorsqu’on souhaite se lancer dans l’investigation ?
Il faut juste se rappeler et insister sur le fait que le journalisme est un métier, qu’il se s’improvise pas, spécialement ce journalisme-là. La première sécurité, c’est la solidité des enquêtes. Il ne faut pas se lancer de manière totalement naïve, il faut bien maîtriser le métier. Une enquête qui est faite professionnellement et qui est solide peut toujours faire l’objet de poursuites. Il y a une justice dans ce pays, la liberté de presse est garantie. Si elle est bien faite, une enquête ne mène pas à la condamnation des journalistes, bien heureusement.
Sur la question de la protection juridique, ce sont effectivement des charges qu’il faut inclure dans le business model d’une publication qui souhaite faire de l’investigation. Plus un média est prospère, plus il peut se permettre d’être incisif. Un média d’investigation qui voudra se lancer sur la base de rien doit d’abord s’entourer de journalistes professionnels qui minimisent ces risques d’exposition judiciaire, et doit inclure dans son modèle d’affaires une assurance juridique. Le risque juridique doit être intégré à tout projet de lancement de médias, rien que pour les problèmes de droits d’auteurs ou de contrat de travail.
Racontez-nous une affaire qui a marqué votre carrière ?
Je pense à l’affaire que j’ai menée sur les rapports entre la Suisse et l’Afrique du Sud de l’apartheid, en 1998-99, en particulier sur la collaboration que les militaires suisses ont eue avec le régime d’apartheid en Afrique du sud dans le domaine des armes chimiques et bactériologiques. C’est une enquête qui a révélé qu’un des hauts responsable sud- africain de ce programme avait des contacts étroits avec le chef du service des renseignements militaire suisse. Cela a conduit à plusieurs enquêtes parlementaires, et cela m’a moi-même conduit à faire un petit séjour en prison en Afrique du sud… Cela a été l’occasion de réfléchir au rôle que la Suisse a joué dans le régime raciste d’apartheid. Au final, le chef du service des renseignements a dû démissionner, entre autres à cause de cette affaire.
https://rts.ch/play/tv/redirect/detail/5454026
Je pense aussi à un reportage que j’ai fait pour Temps Présent, Securitas : un privé qui vous surveille. L’enquête raconte comment Nestlé a recruté Securitas pour espionner des militants du groupe tiers-mondialiste ATTAC. Securitas a infiltré une jeune femme en tant qu’espionne au sein du groupe pour rapporter des informations. On a alors appris que Securitas avait une sorte de service de renseignement absolument pas contrôlé pour le compte de privés. ces révélations ont – conduit à la condamnation en justice civile de Nestlé et de Securitas. Cette affaire a suscité de gros débats au chambres fédérales, et j’ose croire que cela a permis à ces groupes de sécurité- privés de faire le ménage chez elles. Le risque que ces groupes nous espionnent et prennent des libertés avec la loi, notamment sur la protection des données, est réel : ce reportage a permis de remettre de l’ordre dans tout ça.
https://rts.ch/play/tv/redirect/detail/510571.
Que ressentez-vous lors de la publication d’une enquête ?
Je dirais qu’il y 3 phases : avant, pendant, après. Avant, il y a une immense angoisse, on doit être sûr que ce que l’on va publier est béton ! On collabore beaucoup avec les collègues et avec le service juridique à la RTS. On ne sait jamais très bien comment la justice pourrait réagir en cas de plainte. On mène une sorte de compliance, c’est-à-dire un processus de vérification serrée.
Au moment où l’enquête sort, on suit avec attention les premières réactions, qui donnent toujours le ton de ce qu’il va se passer. L’affaire peut prendre une ampleur considérable, accompagné d’un moment d’excitation, d’une montée d’adrénaline, mais toujours avec un sentiment d’angoisse. Il faut s’attendre à ce que l’enquête soit critiquée, et assez rapidement, l’enquêteur devient l’enquêté et les questions se retournent.
Et puis, il y a l’après. Parfois, il arrive qu’on soit déçu, car on travaille sur quelque chose qui n’a aucun impact, qui ne fait aucun bruit. On est fier de ce qu’on a fait, mais il a un peu de déception. L’après, c’est là où on mesure vraiment l’impact. Il arrive qu’une partie du travail n’aie une résonance que beaucoup plus tard. Un vieux Temps Présent datant de 1997 sur la maltraitance dans les EMS a dû attendre 3 ans pour avoir un réel impact. C’est aussi lié au fait que certaines archives sont encore verrouillées, particulièrement ceux des services de renseignement et bancaires. Tout une partie de ce qu’on a révélé qui demande encore à être précisé.

Le journalisme d’investigation est-il un moyen de gagner la confiance du public ?
Quand on choisit bien ses sujets, qu’on contribue au débat démocratique, je pense que oui, on gagne la confiance du public. Je pense notamment à l’affaire Maudet, où les journalistes qui ont travaillés sur l’affaire ont littéralement été trainés dans la boue. Mais au final, chacun jugera s’il était d’intérêt public de connaitre le comportement de M. Maudet. La question n’est pas de savoir si le journaliste avait raison ou pas, la question est de savoir si les faits révélés ont un grand intérêt public. Pour moi, la réponse est mille fois oui !
J’aimerais également qu’on rappelle la contribution de ces journalistes au débat démocratique. Prenons l’exemple du COVID. C’est devenu très à la mode de tirer sur le messager : toutes les mauvaises nouvelles apportées sont de la faute des journalistes. Mais qu’on s’arrête une toute petite minute pour considérer où on en serait si l’Etat et les médecins n’étaient que les seules sources d’informations du public en temps de COVID. La contribution des journalistes d’investigations dans le décryptage de la crise COVID, que cela soit du point de vue scientifique, sur le rôle de la Chine par exemple, que cela soit sur la question des masques, que cela soit sur la question politique, des erreurs de gestion, les conflits et les polémiques à l’interne des organes de décision, les questions financières…toutes ces choses ont besoin d’un regard critique, acéré, indépendant, informé, parce qu’il y a un immense pouvoir ou contre-pouvoir qui a intérêt à les cacher. Je vais même plus loin : le travail des journalistes d’investigation sert au pouvoir de décision. Un certain nombre d’informations sont découvertes par les acteurs de décisions officielles dans la presse grâce aux journalistes, et ce sont des enseignements qu’on peut appliquer pour la suite. Le travail des journalistes me semble essentiel, et je pense qu’on a beaucoup de chance de vivre dans un pays où la presse est libre, et où il y a de l’argent qui permet de pratiquer un journalisme d’investigation incisif et de qualité.
L’affaire Darius Rochebin a ébranlé la RTS, l’entreprise qui vous emploie. Qu’avez-vous à dire à ce sujet ?
C’est compliqué pour moi, car je suis astreint à un devoir de réserve, étant à la fois employé au sein de l’entreprise et au courant d’un certain nombre d’informations sur cette affaire. C’est peut-être le point limite des journalistes, celui d’enquêter sur l’entreprise qui les emploie. Personnellement, je suis très satisfait que le fonctionnement des médias soit un thème d’enquête. Nous sommes une industrie qui n’échappe pas au regard critique. Il n’y aurait rien de pire qu’une conspiration du silence des journalistes entre eux. De manière générale, je salue le travail de mes confrères, y compris sur notre propre travail, même si c’est extrêmement douloureux. Ensuite, il faudra voir la conclusion des enquêtes en cours. La question que pose l’affaire Rochebin nous renvoie la question à nous journalistes de ce qu’est une personnalité publique, et dans quelle mesure son droit à l’intimité est limité. C’est une règle qu’on s’applique quand on enquête sur des personnalités politiques. Je pense aux récentes enquêtes sur les déboires d’Alain Berset avec une jeunes femme, et sur la question de la paternité de M. Darbellay. Ce sont des questions extrêmement délicates pour nous : dans quelles mesure ces questions appartiennent à leur intimité ? Dans quelle mesure ces questions appartiennent à la sphère publique et doivent être connues des électeurs ? Finalement, je suis moi-même porteur d’image : dans quelle mesure je me dois moi-même d’être totalement irréprochable dans ma vie privée et personnelle ? Dans quelle mesure ai-je aussi droit à mes erreurs et à mon intimité qui n’est pas du ressort du public ? Ce sont des questions auxquelles l’affaire Rochebin nous renvoient comme journalistes et porteurs d’image.