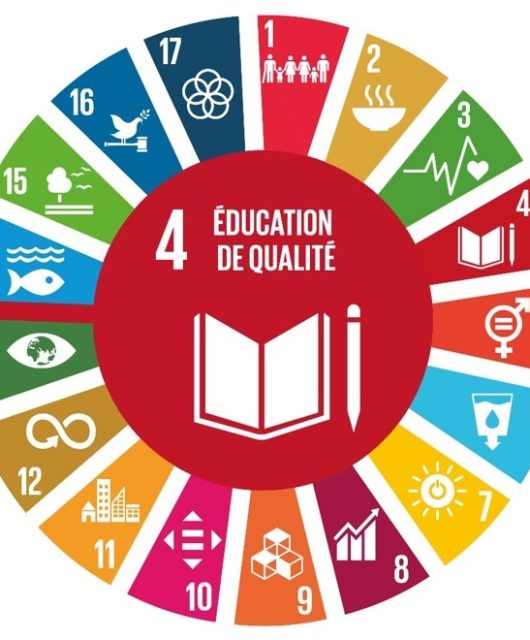Pouvoir et (dé)mesure
Plus fort·e, plus intelligent·e, plus sage, plus apte à prendre les bonne décisions… Le·la dirigeant·e est-il·elle un être supérieur aux autres, ou quelqu’un de tout aussi faillible, voire corruptible ?
Encadré (QR code) : Pour aller plus loin, l’interview du conseiller fédéral Guy Parmelin par nos collègues d’Unimix
Depuis que les sociétés humaines existent, il faut bien les administrer. De là à idéaliser la figure du·de la chef, il n’y a qu’un pas pour le·la considérer comme un être supérieur aux autres. Notre imaginaire actuel concernant les représentant·e·s du pouvoir est encore probablement nourri de toutes ces figures dirigeantes du passé, souvent mythifiées, à l’image d’Alexandre le Grand, des pharaons égyptiens ou encore du roi français Louis XIV.
Dans ce contexte, outre les orientations politiques et la manière d’exercer le pouvoir, quelles distinctions peut-on faire entre Guy Parmelin et Vladimir Poutine, entre la Reine d’Angleterre et Emmanuel Macron, ou encore entre Napoléon et Barack Obama ? Quelles croyances subsistent, lesquelles ont-pu sauter au fil des siècles à mesure que la transition vers un pouvoir démocratique s’est normalisée dans nos sociétés occidentales ? Comment cette vision a-t-elle pu évoluer à travers les époques ?
Pour tenter de répondre à ces questions, les analyses de la professeure Nadine Amsler, spécialiste de l’histoire des dynasties et du catholicisme, et celles du professeur Cédric Brélaz, dont l’expertise concerne les civilisations gréco-romaines, sont très précieuses.

Que nous dit le passé ?
« La vision des hommes d’État et chefs militaires antiques a pendant longtemps été imprégnée de l’idéalisation de leurs actions qui a été véhiculée par les auteurs anciens eux-mêmes, en particulier Plutarque dont l’œuvre a eu une influence considérable dans la formation des élites aristocratiques, puis bourgeoises de l’Europe moderne et contemporaine », nous éclaire le professeur Brélaz
Encore aujourd’hui, ne nous souvenons-nous pas de César, d’Alexandre ou de Cicéron comme des figures quasi mythiques, situées quelque part entre l’Histoire et la légende ? « L’histoire a pendant longtemps consisté en un récit magnifiant l’action militaire de chefs individuels ou d’autocrates. […] Aussi brillant ou puissant soit-il, un·e chef n’est rien sans l’adhésion, volontaire ou contrainte, de la majorité d’une population », poursuit Cédric Brélaz
Il semble pertinent de relever ici que les grandes figures dont nous parlons sont presque toutes exclusivement masculines. Les noms de Cléopâtre ou de la reine Victoria y font figure d’exception. L’emprise du patriarcat sur l’ensemble de la société, dont l’étude de l’histoire fait partie, est heureusement en train de s’éroder au profit d’une véritable science historique, comme le relève le professeur Brélaz : « Le souci actuel de la recherche scientifique en histoire de l’Antiquité consiste précisément à se détacher de ces modèles et de cette approche moralisante pour analyser les ressorts du commandement politique et militaire dans l’Antiquité dans leur contexte politique, institutionnel et social. Il s’agit en particulier de se défaire de l’image du “grand homme” en insistant moins sur des personnalités que sur des structures ».
Psychologiser le pouvoir ?
La professeure Amsler nous déconseille d’essayer d’entrer dans la tête de figures historiques : « Nous historien·ne·s […] sommes normalement très hésitant·e·s à “psychologiser” les actions des personnes historiques. […] Les historien·ne·s n’ont pas les outils pour reconstruire cette vie intérieure. Au lieu de cela, nous nous intéressons aux “faits sociaux” qui peuvent être reconstruits à travers des textes et des images ».
Si nous éviterons donc de trop nous aventurer sur le terrain de la psychologie, que pouvons-nous déduire de « faits sociaux » qui prétendent que les représentant·e·s du pouvoir sont d’ascendance divine ? Les pharaons égyptiens par exemple se prétendaient tour à tour Dieu ou fils de Dieu, même si l’on peut également évoquer la monarchie de droit divin – c’est-à-dire que le pouvoir du monarque souverain est légitimé par la volonté de Dieu -, dont Louis XIV est sans doute un des plus célèbres représentants. Sans forcément aller jusqu’à des figures de pouvoir aussi totales, l’analyse de la professeure Amsler, experte de l’histoire des cours et familles princières en Europe, ainsi que de l’histoire du catholicisme dans une perspective globale, nous éclaire grandement.
« Dans la société prémoderne, la hiérarchisation sociale et l’idée que les hommes n’étaient pas tous égaux étaient un “fait social” généralement accepté. Pour les princes, il était donc très normal de penser qu’en tant qu’issu d’une famille noble et régnante, ils étaient supérieurs aux autres hommes. Pourtant, l’éducation servait souvent le but de sauver les princes du péché de l’hybris [péché d’orgueil et d’arrogance, ndlr] ». L’emprise de la religion chrétienne, et plus particulièrement celle du catholicisme, était immense sur la vie de toute l’Europe occidentale au Moyen-Âge, et même plus tard.
Nadine Amsler poursuit : « L’éducation religieuse était très importante, et cette éducation a prêché aux princes, de même qu’aux autres hommes, qu’un bon chrétien devait cultiver l’humilité. Il va de soi que tous les princes n’ont pas intériorisé ces vertus chrétiennes de manière sérieuse […]. En plus, il faut tenir compte du fait que la situation de l’éducation princière était au fond une situation paradoxale, l’enfant qui devait être éduqué ayant un statut social supérieur aux éducateur·trice·s ».
La désacralisation du pouvoir ?
De nos jours, la situation a bien changé et, entre temps, la Révolution française est passée par là. Pour rester dans ce pays, le cas d’Emmanuel Macron semble toutefois révélateur de ce que certains appellent la « monarchie présidentielle ». Pour la petite histoire, au début de son premier mandat, le président Macron déclarait (visiblement sans s’étouffer sur son ego) souhaiter une présidence « jupitérienne », faisant ainsi référence au dieu romain qui gouverne tous les autres.
Bien qu’il reste encore malheureusement des Vladimir Poutine, des Xi Jinping ou encore des Kim Jong-Un pour conserver une sorte de fascination malsaine pour la verticalité du pouvoir et à vouloir continuer à jouer à « qui a la plus grosse (force de dissuasion nucléaire) ? », nos sociétés modernent tendent à désacraliser la figure du pouvoir. Le fait que, dans nos démocraties occidentales du moins, les dirigeant·e·s ne restent jamais plus de quelques années au pouvoir y contribue très certainement. De plus, en Suisse, notre parlement de milice et la proximité que nous pouvons avoir avec nos élu·e·s renforce notre démocratie.
La place nous manque pour évoquer en détail l’autre versant de cette désacralisation, à savoir la volonté d’exemplarité que de plus en plus de peuples exigent de la part de leurs élus, pour le meilleur comme pour le pire. Pour contribuer à votre réflexion, nous finirons donc sur ces paroles du professeur Brélaz : « Le fait de juger des dirigeant·e·s contemporain·e·s à l’aune de figures idéalisées antiques ne rend justice ni à la recherche historique ni à l’analyse politique des faits présents. Ce sont des raccourcis qui témoignent d’une instrumentalisation du passé. » Nous voilà averti·e·s.